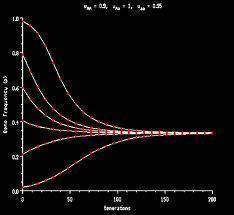La sélection naturelle et le maintien du polymorrhisme
Cas des valeurs sélectives constantes
C’est le cas classique de l’anémie à hématies falciformes ou drépanocytose ou encore sicklémie. La forme mutée de l’hémoglobine, qui est notée S, est caractérisée par la substitution d’un acide aminé acide glutamique hydrophile par une valine hydrophobe sur la chaîne p. En conséquence les molécules d’hémoglobine cristallisent à l’état oxygéné et les hématies présentent alors une forme en faucille ce qui entraîne un blocage des capillaires. L’allèle est létal à l’état homozygote dès l’enfance, les sujets atteints ne dépassant généralement pas l’âge de 5 ans. Son maintien à fréquence élevée dans certaines populations (45% d’hétérozygotes localement) s’explique par une meilleure résistance au paludisme. On observe en effet une assez bonne concordance entre les zones où sévit le paludisme et celles où l’on rencontre l’anémie à hématies falciformes. Les sujets sicklémiques hébergent de plus généralemem moins de parasites que les sujets non sicklémiques.
Le paludisme est une maladie causée par un protozoaire, Plasmodium falcipanw:. qui possède deux hôtes : l’homme et l’anophèle (moustique). Le passage d’un hôte à l’autre îc fait par piqûre de moustique. Chez l’homme, le parasite se multiplie dans les cellules du fo;e dans un premier temps puis dans les hématies. La résistance conférée par l’allèle S serait due à une destruction plus rapide des hématies contenant un mélange des deux hémoglobines ce qui empêche le parasite d’y terminer son cycle ou à l’absence chez le parasite d’un équipement enzymatique lui permettant de métaboliser l’hémoglobine S. Ce polymorphisme est un exemple de surdominance où les hétérozygotes sont avantagés. Simple et pédagogique, il est cependant tout à fait exceptionnel et il ne faut pas trop généraliser à partir de son étude. Les cas de vigueur hybride, ou hétérosis, sont en effet plus souvent dus à l’addition des effets bénéfiques des gènes hérités de chacun des deux parents qu’à une surdominance.
Cet exemple pose aussi un autre problème d’ordre génétique. Les deux homozygotes se reproduisent mal et ils abaissent la capacité de la population à se reproduire. Le généticien Haldane a montré que le remplacement d’allèles anciens par des allèles nouveaux sous l’effet de la sélection naturelle pouvait faire baisser leurs effectifs jusqu’à les menacer d’extinction. Ce coût de la sélection empêche donc d’invoquer l’avantage de l’hétérozygote pour expliquer le maintien d’un nombre aussi important d’allèles mutés.
De façon générale, il est très difficile de mettre en évidence une sélection naturelle s’exerçant sur un locus particulier. En général, on a recours pour ces études à une analyse des protéines et en particulier des enzymes. Mais quand un polymorphisme enzymatique est mis en évidence par électrophorèse, il est difficile de donner une fonction exacte aux enzymes et ¿’attribuer un avantage sélectif à certains génotypes plutôt qu’à d’autres. Il faudrait pour cela mesurer leur survie et leur fertilité et ce travail est colossal. De plus, il y a souvent plusieurs ¿cteurs sélectifs en cause et il est très difficile de les déterminer. Ces études se limitent sou- i Tent à montrer que plus des populations sont éloignées géographiquement, ou plus le flux de [ ssnes entre elles est faible, plus elles diffèrent. Un piètre résultat pour une technique aussi phistiquée. Par contre, les analyses enzymatiques se prêtent bien à la mise en évidence f isolement reproducteur. C’est le cas entre les souris Mus musculus et Mus spretus dans le : de la France (Bonhomme & Thaler 1988).
La sélection varie dans l’espace et le temps
Une même espèce peut aussi subir des pressions de sélection différentes sur son aire de ition ce qui maintient un polymorphisme. C’est l’exemple d’un Lépidoptère : la Tordu chêne Tortrix viridana (du Merle 1981, 1998). Les adultes de ce défoliateur du volent au début de l’été. Les œufs sont déposés par deux sur l’écorce des rameaux et t au printemps suivant après une diapause estivo-hivemale. Les chenilles se dévelop- t au départ à l’intérieur des bourgeons et les stades les plus âgés se nourrissent des feuilles s de développement. Comme elles s’introduisent dans les bourgeons lorsqu’ils ont cé à débourrer, il doit y avoir synchronisme entre débourrement des chênes et éclo- des œufs. Dans le midi de la France il existe deux espèces de chênes. Le Chêne t (Quercus pubescens) est une essence caducifoliée qui préfère les sols profonds. Il tôt et rapidement. Le Chêne vert (Quercus ilex) est une essence sempervirente qui ;e les sols secs et rocailleux. Il débourre tard et lentement. L’écart entre les phénologies arbres est de deux à trois semaines. Or on constate que les œufs de tordeuse éclosent ilôt sur chêne pubescent que sur chêne vert. Le tableau ci-dessous donne les résultats etude menée dans le massif du Mont Ventoux (d’après du Merle1981).
On voit que la tordeuse peut se développer à la fois sur chêne vert et sur chêne pu’ cent car ses œufs éclosent plus tôt sur chêne pubescent que sur chêne vert. Diverses expén-l ences ont montré que cette adaptation est génétique. Des papillons issus de chacune des demi populations s’accouplent sans difficulté et leurs œufs sont fertiles. Les descendants ont une date d’éclosion intermédiaire. Ils sont donc contre sélectionnés. On a un polymorphisme maintenu au sein d’une espèce par des conditions environnementales variables dans l’espace mais avec une hétérogénéité à maille fine car les deux chênes cohabitent à peu de distance l’un de l’autre. On peut d’ailleurs se demander comment ce polymorphisme est apparu et comment il se maintient dans les milieux méditerranéens en mosaïque où les deux espèces de chênes ont des répartitions qui s’interpénétrent largement.
Le Gros-bec ponceau à ventre noir Serenistes ostrinus, un passereau africain, fournit un exemple de sélection variable mais cette fois-ci dans le temps (Smith 1987, 1993). Certains! caractères biométriques du bec présentent une distribution bimodale chez les deux sexes alors que pour les autres caractères morphométriques on a des répartitions qui suivent une loi normale. Plus simplement, il y a dans les populations des individus à gros bec et des individus à petit bec. Les oiseaux des deux types s’accouplent au hasard. Les descendants d’un oiseau à gros bec et d’un à petit bec sont pour partie à gros bec et pour partie à petit bec. Le caractère semble génétique. Les oiseaux à gros bec sont plus efficaces pour consommer des graines grosses et dures d’une espèce de carex alors que ceux à bec fin sont plus efficaces pour consommer des graines petites et plus tendres d’une autre espèce de carex. Il y aurait donc deux types d’individus au sein de l’espèce différant par leur niche écologique. Le problème est de déterminer comment est apparu ce polymorphisme qui n’est pas lié au sexe. On peut supposer que des conditions climatiques variables dans le temps, en favorisant alternativement chacune des deux espèces de carex, favorisent alternativement chacun des deux morphes. On a donc une sélection variable dans le temps qui maintient un polymorphisme. Les travaux menés sur les Pinsons de Darwin fournissent un autre exemple d’une sélection de ce type.
Une sélection qui s’exerce dans des directions différentes au cours du temps peut ainsi sélectionner des génotypes différents au cours du temps et maintenir un polymorphisme. Il faut cependant que les changements dans la sélection soient assez lents pour que chaque individu n’ait pas à subir l’ensemble des conditions et assez rapides pour qu’aucun des allèles n’ait le temps de se fixer.
La sélection fréquence dépendante
C’est le cas des allèles qui sont avantagés lorsqu’ils deviennent rares. C’est classique dans le cas des systèmes prédateurs-proies. Les prédateurs s’attaquent de préférence aux proies qu’ils reconnaissent et donc à celles qui appartiennent au type le plus fréquent. Les types rares seront sélectionnés jusqu’à ce qu’ils deviennent les plus abondants d’où une possible sélection qui varie dans le temps. Nous en avons vu un exemple avec la Phalène du bouleau. Un autre exemple où ce type de sélection s’opère, mais entre espèces, concerne les insectes qui imitent des espèces non comestibles (Ridley 1997, Fisher & Henrotte 1998). Par exemple, le Monarque (Danaus plexipus) est un papillon qui provoque des nausées immédiates chez un oiseau qui le consomme. Cette propriété est due à une molécule fabriquée par une plante dont se nourrit la chenille. Les oiseaux apprennent rapidement à reconnaître ces insectes. Après avoir tenté d’en consommer une fois, ils évitent de les capturer. Une autre espèce de papillon, le Vice-roi (Limenitis archippus) n’est pas toxique mais imite la forme et les couleurs des monarques. Ce mimétisme, qualifié de batésien, les protège donc de la prédation par les oiseaux. Cette stratégie impose cependant que la fréquence de l’imitateur ne dépasse pas celle de l’espèce imitée.
Chez le papillon Papilio memnom, on a montré que les gènes qui contrôlent la forme et la couleur de l’aile et qui permettent d’imiter des espèces non comestibles pour les oiseaux sont situés les uns à côté des autres sur le chromosome. Ils sont donc transmis comme une seule unité ou supergène. Cette association intime des gènes diminue fortement les recombinaisons et permet de conserver de génération en génération le phénotype imitateur (Gilbert 1996).
Vidéo : La sélection naturelle et le maintien du polymorrhisme
Vidéo démonstrative pour tout savoir sur : La sélection naturelle et le maintien du polymorrhisme